Rechercher
Derniers sujets
» Goldwing > 2018 . Tuto pose de déflecteurs supérieurs pour les nuls par francno Aujourd'hui à 12:07
» Joyeux anniversaire aujourd'hui à ...
par Pépé69 Aujourd'hui à 10:27
» Vidéos à la suite....
par g2loq Aujourd'hui à 8:19
» Une image marrante ou insolite par jour...en forme toujours
par g2loq Aujourd'hui à 7:53
» Malus pour voitures neuves et d'occasion, le gouvernement veut tout augmenter
par chris5 Hier à 21:10
» Météo
par DenisFont85 Hier à 11:07
» Fin de ma période Goldwing
par Claude 38 Hier à 10:18
» Citations
par g2loq Hier à 8:40
» changement d'embrayage sur GL 1200 Aspencade ?
par Philoup61CH Hier à 8:14
» Visu Ariège Septembre 2025
par chris 36 Jeu 21 Nov 2024 - 11:20
» elle est bonne ! (vos blagues du jour ici)
par easy rider Jeu 21 Nov 2024 - 7:31
» Un belge en plus en Goldwing (Axelfoley)
par charpentier09 Mer 20 Nov 2024 - 22:55
» Balade des Papas Noël motards Toulousains con
par chris5 Mer 20 Nov 2024 - 19:34
» Château Lavardens et ses expositions dont des santons
par chris5 Mer 20 Nov 2024 - 18:33
» Rencontres toulousaines
par chris5 Mar 19 Nov 2024 - 20:48
» origine de votre pseudo
par Axelfoley Mar 19 Nov 2024 - 18:43
» Malus bruit sur les motos en 2025
par boris-jc Lun 18 Nov 2024 - 17:21
» Que se passe t'il au jardin?
par eddy tionspéciale Lun 18 Nov 2024 - 16:31
» Le V6 PRV fête ses 50 ans, et il vaut mieux que sa réputation !
par g2loq Lun 18 Nov 2024 - 9:33
» historique modèles goldwing et leur immatriculation (VIN)
par g2loq Sam 16 Nov 2024 - 22:29
Connexion
Les 150 ans de la Commune de 1871
3 participants
Goldwing Indépendant :: Le bar :: Le bar
Page 1 sur 1
 Les 150 ans de la Commune de 1871
Les 150 ans de la Commune de 1871
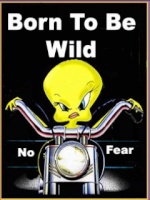
Connaître le passé pour préparer le futur...



Publié le 23 mars 2021 par frico-racing
Les 150 ans de la Commune de 1871
1871 : la Commune de Paris, pour une alternative économique et sociale
Par Gérard Vindt 01/03/2021 Alternatives Economiques n°410
Écrasée dans le sang, l’éphémère Commune, patriote, farouchement républicaine, aspirant à une démocratie directe, a aussi proposé une autre vision de la société et de l’économie.
Soixante-douze jours seulement, du 18 mars au 28 mai 1871, et pourtant !
La Commune de Paris, cent cinquante ans après, ne laisse toujours pas indifférent. Car si elle clôt le siècle des révolutions amorcé en 1789 en France, elle ouvre aussi des perspectives toujours d’actualité.
/image%2F1444795%2F20210228%2Fob_edeec9_t7-ico-038bis-1830-16-0.jpg)
Une période troublée
L’insurrection parisienne naît de la situation politique troublée qui suit la chute du second Empire après la défaite de Sedan face aux Prussiens le 2 septembre 1870. Le 4 septembre, la population parisienne se mobilise pour proclamer la République à l’hôtel de ville. Mais Paris est bientôt assiégé par les Prussiens. Toutes les tentatives de contre-attaques des Parisiens comme celles des armées levées en province par Gambetta échouent. Le gouvernement provisoire se résout à signer l’armistice le 28 janvier 1871. Les plus combatifs des Parisiens qui ont résisté au siège de la ville pendant quatre mois se sentent trahis, eux qui espéraient un sursaut patriotique à l’image de la France de 1792 qui s’était mobilisée pour défendre « la patrie en danger ».
Autre facteur de révolte : les élections législatives du 8 février 1871 devant permettre d’établir un gouvernement légal, issu du suffrage universel masculin en vigueur à l’époque, apte à négocier avec l’ennemi. Le pays, très majoritairement rural, vote massivement pour des candidats monarchistes partisans de la paix (400 élus !), contre 150 républicains. L’Assemblée désigne comme chef du gouvernement un orléaniste conservateur, partisan d’une monarchie constitutionnelle, Adolphe Thiers. Pour le Paris viscéralement républicain, à la trahison s’ajoute maintenant la menace d’un retour de la monarchie d’avant 1848. Les militants parisiens, des républicains modérés aux révolutionnaires socialistes ou anarchistes, s’imposent au sein de la garde nationale * , qui nomme un comité central.
Lorsque, le 18 mars, le gouvernement tente de reprendre les canons de la garde nationale parqués sur la butte Montmartre, c’est l’insurrection. Le gouvernement de Thiers quitte précipitamment Paris, passé aux mains des insurgés, pour Versailles. Le 26 mars, Paris élit un gouvernement communal de 79 membres, majoritairement issus des classes populaires et des courants révolutionnaires de gauche, des républicains jacobins, mais aussi des membres de l’Association internationale des travailleurs ou des syndicats ouvriers. La Commune est d’abord une insurrection politique, pour une république décentralisée et une démocratie directe où les représentants du peuple ont des mandats impératifs et sont révocables – une proposition politique qui n’est pas sans écho aujourd’hui.
C’est aussi, comme l’écrit l’historien Quentin Deluermoz, une « expression historique du possible » dans les domaines économiques et sociaux.
Mais d’abord, de quels moyens dispose la Commune pour mettre en œuvre ses projets dans ces domaines ? Le pouvoir a quelques moyens financiers. 6 millions de francs * ont été trouvés dans les ministères et à l’hôtel de ville, 2 millions proviennent de taxes perçues sur les cinq compagnies de chemin de fer, 26 millions sont perçus à l’octroi, cette douane municipale taxant les produits entrant dans la ville.
La Banque de France, auprès de laquelle la ville de Paris a un compte, lui verse un peu moins de 20 millions de francs. « On a estimé les dépenses de la Commune à 42 millions de francs », écrit l’historien spécialiste de la Commune Jacques Rougerie.
Le problème dans ces quelques semaines n’est pas tant le manque d’argent que l’absorption des trois quarts du budget par la défense contre les attaques du gouvernement installé à Versailles. Outre les dépenses militaires matérielles, il faut assurer la solde des gardes nationaux qui combattent, pensionner les blessés, les veuves, les orphelins…
Pour une propriété issue du travail
Plus que de moyens matériels, c’est en réalité de temps qu’a manqué la Commune pour mettre concrètement en place les politiques qu’elle a décidées. Car elle doit d’abord prendre des mesures d’urgence. Pour faire face à la détresse sociale liée au siège et à la guerre civile, elle organise des secours aux miséreux, décrète des remises des loyers échus, un moratoire des échéances des petits commerçants, réquisitionne des logements laissés vacants par des opposants à la Commune ayant fui à Versailles, restitue gratuitement des objets déposés par les plus pauvres au mont-de-piété.
Pour autant, la Commune ouvre des chemins qui seront pour beaucoup repris dans les décennies suivantes par la IIIe République ou s’inscriront dans les programmes des organisations socialistes et ouvrières.
Concernant la question de la propriété, d’abord. Les communards défendent la propriété issue du travail. Ils s’en prennent aux « spéculateurs » et aux « accapareurs » qui privent l’ouvrier d’une « juste propriété », dans une vision inspirée par Proudhon. Les communards défendent une société de petits producteurs propriétaires, et pour cause : à Paris, dans les années 1860, sur 100 000 patrons, 31 000 emploient de deux à dix salariés, 62 000 un seul ou aucun. Le peuple de Paris est d’abord un peuple de l’atelier et de la boutique. Mais les communards promeuvent aussi l’association de producteurs organisés en coopératives : ainsi réquisitionnent-ils les ateliers abandonnés par leurs patrons en vue de les confier en autogestion aux salariés ; faute de temps, dans la pratique, seul un atelier de fonderie sera géré de manière collective.
Un programme social-révolutionnaire
La commission du travail au sein de la Commune est à l’origine de plusieurs lois. Elle propose de supprimer le travail de nuit des ouvriers boulangers, interdit les retenues sur salaire qui sont monnaie courante pour des fautes bénignes supposées dans les ateliers et administrations. Elle décide le 5 avril la mise en place de bureaux municipaux d’arrondissement enregistrant offres et demandes d’emplois afin de permettre à l’ouvrier de se passer d’intermédiaires parasites pour trouver du travail.
Pour les marchés liés à la défense, la Commune veut donner systématiquement préférence aux associations ouvrières de tailleurs et cordonniers contre les gros fabricants tel Alexis Godillot, l’industriel de l’habillement et de la chaussure.
Côté service public, la Commune s’intéresse particulièrement à l’école. Dans le cadre de la séparation de l’Église et de l’État décrétée le 2 avril, l’enseignement laïc, gratuit et obligatoire est institué et, mi-mai, sont statués le doublement du traitement des instituteurs et l’égalité de celui des institutrices avec celui de leurs collègues masculins. Une commission spéciale est constituée pour l’enseignement des filles. La rénovation des programmes et des méthodes pédagogiques afin de mieux les adapter aux milieux populaires est discutée avec la participation d’associations comme la Société de l’Éducation nouvelle, où militent de nombreuses femmes. Des chantiers ouverts par la Commune, certains aboutissent dans les décennies suivantes, d’autres restent inachevés. Mais un siècle et demi plus tard, le symbole qu’est cette tentative de révolution sociale reste toujours bien présent.
*Millions de francs : l’équivalence avec les euros d’aujourd’hui est difficile. Le plus souvent est donnée une équivalence de 1 million de francs de 1871 à environ 4 millions d’euros d’aujourd’hui, compte tenu des variations monétaires dues à l’inflation. Mais ce million de francs 1871 vaut alors 300 000 fois le salaire ouvrier journalier (autour de 3 francs). Ce qui, aujourd’hui, avec un Smic quotidien d’environ 80 euros, équivaudrait à 24 millions d’euros. Le coefficient de conversion ne serait donc plus 4, mais 24…


g2loq- Co-administrateur

- Messages : 22944
Date d'inscription : 29/04/2013
Age : 70
 Re: Les 150 ans de la Commune de 1871
Re: Les 150 ans de la Commune de 1871
Salut,
Ce fut encore une révolution hélas manquée...
Soyons vigilants!

Ce fut encore une révolution hélas manquée...
Soyons vigilants!
Dernière édition par Max 31 le Mer 24 Mar 2021 - 22:17, édité 1 fois

Max 31- Membre incontournable !

- Messages : 834
Date d'inscription : 19/02/2021
Age : 64
 Re: Les 150 ans de la Commune de 1871
Re: Les 150 ans de la Commune de 1871
Une synthèse historique très intéressante à lire.
Merci de l’avoir fait. C’est d’ailleurs passé sur Arte hier soir. Bon c’est vrai qu’à 22h je me suis éteint mais c’était intéressant.
Merci de l’avoir fait. C’est d’ailleurs passé sur Arte hier soir. Bon c’est vrai qu’à 22h je me suis éteint mais c’était intéressant.

Invité- Invité
 Re: Les 150 ans de la Commune de 1871
Re: Les 150 ans de la Commune de 1871
pas tout compris !!!
vous inquiété pas c'est l'age



vous inquiété pas c'est l'age





teurteul73- Membre incontournable !

- Messages : 430
Date d'inscription : 11/10/2020
Age : 59
 Re: Les 150 ans de la Commune de 1871
Re: Les 150 ans de la Commune de 1871
Salut
N'oublions pas qu'en cas de révolte, les femmes sont, furent et/ou seront toujours en première ligne (1er et second degré déjà inclus )
)
Je viens de tomber sur cet article qui date un peu mais qui rappelle au sujet du post.
Femmes de la Commune de Paris
Les Louises en insurrection
Blanchisseuses, relieuses, cantinières, journalistes… celles que leurs adversaires appelleront les « pétroleuses » interviennent splendidement dans les combats de la Commune : ceux qui se mèneront les armes à la main, ceux qui entreprennent de construire un monde plus juste et plus heureux. Elles sont privées du droit de vote, mais elles se font entendre dans les clubs de quartier, demandent l’égalité des salaires et la création de crèches, engagent la reconnaissance de l’union libre. La Commune fut exterminée, les idées et les idéaux survécurent.
Tous les dessins qui accompagnent cette double page sont d’Éloi Valat. Ils sont, pour la plupart, extraits de son ouvrage Louises, les femmes de la Commune, Bleu autour, Saint-Pourçain-sur-Sioule, 2019.
Le 26 mars 1871, 229 167 électeurs parisiens se rendent aux urnes pour désigner le conseil communal de « Paris, ville libre ». Une majorité révolutionnaire l’emporte. Des socialistes, des blanquistes, des républicains radicaux ou modérés composent cette nouvelle assemblée où les travailleurs manuels sont les plus nombreux, aux côtés d’employés, d’artisans patrons, de journalistes et de membres des professions libérales, pour la plus grande partie des hommes jeunes. Privées du droit de vote, les femmes sont absentes. Pas de citoyennes pour légiférer « la sociale ». Pourtant, elles sont actives et engagées, les femmes — et, comme le dit Jules Vallès, « Grand signe ! Quand les femmes s’en mêlent, quand la ménagère pousse son homme, quand elle arrache le drapeau noir qui flotte sur la marmite pour le planter entre deux pavés, c’est que le soleil se lèvera sur une ville en révolte (1) ».
Une dizaine de jours plus tôt, dans la nuit du 17 au 18 mars 1871, Adolphe Thiers, chef de l’exécutif de la République française, a ordonné l’enlèvement des canons de la garde nationale des parcs d’artillerie des Buttes-Chaumont, des Batignolles, de Montmartre... Prudence gouvernementale. Mais ces canons ont été payés par les Parisiens. La garde refuse. À 5 h 30, la troupe se répand dans les rues de Paris. Les dépêches militaires se succèdent. « 10 h 20. Beaucoup d’effervescence dans le XIIe [arrondissement]. Des gardes nationaux ont barré la rue de la Roquette par deux barricades ; d’autres descendent vers la Bastille... 10 h 30. Très mauvaise nouvelle de Montmartre. La troupe n’a pas voulu agir. Les Buttes, les pièces et les prisonniers ont été repris par les insurgés qui ne paraissent pas descendre (2). » Le tocsin ameute les quartiers populaires, de Belleville à la barrière d’Enfer (place Denfert-Rochereau). À Montmartre, les femmes et les enfants s’opposent vivement aux officiers du 88e de ligne. Des ménagères saisissent les rênes des chevaux, coupent les harnais, on crie : « Vous ne tirerez pas sur le peuple ! », « Vive la ligne ! »
Le 88e fraternise avec la foule. Louise Michel s’est précipitée, sa carabine sous son manteau : « Nous montions au pas de charge, sachant qu’au sommet il y avait une armée rangée en bataille. Nous pensions mourir pour la liberté. On était comme soulevés de terre. Nous morts, Paris se fût levé. Les foules à certaines heures sont l’avant-garde de l’océan humain. La butte était enveloppée d’une lumière blanche, une aube splendide de délivrance. (...) Ce n’était pas la mort qui nous attendait sur les Buttes (...) mais la surprise d’une victoire populaire. » Les généraux Claude Martin Lecomte et Jacques Léonard Thomas (dit Clément-Thomas), prisonniers des soldats insurgés, sont fusillés rue des Rosiers. Pour Louise Michel, « la Révolution était faite. Lecomte, arrêté au moment où pour la troisième fois il commandait le feu, fut conduit rue des Rosiers où vint le rejoindre Clément-Thomas, reconnu tandis qu’en vêtements civils il étudiait les barricades de Montmartre. Suivant les lois de la guerre ils devaient périr. (...) Le soir du 18 mars, les officiers qui avaient été faits prisonniers avec Lecomte et Clément-Thomas furent mis en liberté » (3).
Gaston Da Costa, alors aux côtés des insurgés, entendra dans ses Mémoires séparer le bon grain de l’ivraie : « Jusqu’au moment où la troupe lâche pied, ce sont les femmes qui dominent. Rue des Rosiers, à l’heure du meurtre, elles auront pour la plupart disparu. » Mais il ne recule pas, lui, le communard, devant l’évocation d’images fréquentes chez les adversaires de la Commune : « Cependant, aux épouses, aux mères a succédé, dans cette foule très mêlée, qui va escorter jusqu’aux buttes les prisonniers du Château-Rouge, l’horrible phalange des filles soumises et insoumises (...) sorties des hôtels, cafés et lupanars (...). Au bras des lignards, accompagnées de la légion des souteneurs, elles ont surgi, triste écume de la prostitution sur le flot révolutionnaire, et les voilà s’enivrant à tous les comptoirs, hurlant leur gueuse joie de cette défaite. (...) Joignez-y quelques pauvresses démoralisées par les atteintes délétères de la misère, qui, à l’angle de la rue Houdon, dépècent la chair, chaude encore, du cheval d’un officier tué quelques instants auparavant. Toutes se répandront dans Montmartre, promenant leur ivresse, leur folie haineuse, et feront une abominable escorte au malheureux Lecomte et à ses officiers, lorsqu’ils graviront le Calvaire des Buttes (4). »
Dix jours plus tard, le 28 mars, place de l’Hôtel-de-Ville, la Commune est proclamée « au nom du peuple ». La fête est grandiose. Le canon tonne pour saluer l’événement, le tocsin est muet. Victorine Brocher écrit : « Cette fois nous avions la Commune ! (...) Après tant de défaites, de misères et de deuils, il y eut une détente, tous étaient joyeux. (...) À la tête des bataillons au repos, des cantinières en costumes différents s’accoudent aux mitrailleuses. (...) Un membre de la Commune proclame les noms des élus du peuple, un cri s’élève, unanime : “vive la commune !” (5) »
Les femmes ne siègent pas dans l’assemblée communale. Elles manifestent, organisent leurs comités (d’arrondissement et de vigilance), rédigent adresses et manifestes, ces ambulancières, ces vivandières engagées au sein des bataillons de fédérés pour la défense des forts d’Issy et de Vanves, et bientôt sur les barricades de la « semaine sanglante ».
Le 11 avril, au Journal officiel — de la Commune —, paraît l’appel d’un « groupe de citoyennes » : « Paris est bloqué, Paris est bombardé... (...) Est-ce l’étranger qui revient envahir la France ? (...) Non, ces ennemis, ces assassins du peuple et de la liberté sont des Français !... (...) Ils ont vu le peuple se soulever en s’écriant : “Pas de devoirs sans droits, pas de droits sans devoirs ! (...) Nous voulons le travail, mais pour en garder le produit... Plus d’exploiteurs, plus de maîtres !... Le travail et le bien-être pour tous, le gouvernement du peuple par lui-même, la Commune, vivre libres en travaillant ou mourir en combattant !” »
Le 12 avril, dans Le Cri du peuple : « Que la commune ouvre donc immédiatement aux femmes trois registres sous ces titres : Action armée, Postes de secours aux blessés, Fourneaux ambulants. Elles s’inscriront en foule, heureuses d’utiliser la sainte fièvre qui brûle les cœurs. »
Le 14 avril, au Journal officiel, l’Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés souligne : « Il est du devoir et du droit de tous de combattre pour la grande cause du peuple, pour la Révolution. (...) La Commune, représentante du grand principe proclamant l’anéantissement de tout privilège, de toute inégalité, par là même est engagée à tenir compte des justes réclamations de la population entière, sans distinction de sexe, distinction créée et maintenue par le besoin de l’antagonisme sur lequel reposent les privilèges des classes gouvernantes. »
Dans les clubs, ouverts dans les églises et parfois exclusivement féminins, la parole est libérée. Tout est sujet à prêches et à débats : la défense de la révolution, l’éducation des filles, la parité des salaires, les lois sociales, l’union libre, la lâcheté des hommes, la fin de l’exploitation du travail... Le 3 mai, à l’ouverture du Club de la révolution sociale, dans l’église Saint-Michel comble, à Batignolles, « on sentait qu’en partant se battre pour la Commune les maris avaient laissé au logis un germe solide d’idées révolutionnaires ». On se quitte sur Le Chant du départ et la Marseillaise, avec pour ordre du jour de la prochaine séance : « La femme par l’Église et par la Révolution » (6).
Paul de Fontoulieu, d’une plume acrimonieuse trempée dans le bénitier versaillais, décrit à charge ce qu’il dit y avoir vu et entendu : « Club Éloi — Parmi les oratrices, pardon du mot, (...) la citoyenne Valentin, fille publique qui, le 22 mai, brûla la cervelle à son souteneur, parce qu’il ne voulait pas aller sur les barricades. Et la citoyenne Morel, qui avait subi cinq condamnations (...) : “Je demande, pour en finir, que l’on jette dans la Seine toutes les religieuses, il y en a dans les hôpitaux qui donnent du poison aux fédérés blessés.” Église Saint-Lambert à Vaugirard, Club des femmes patriotes — La réunion de Vaugirard fut présidée par une Autrichienne, du nom de Reidenhreth, (...) une sorte de bas-bleu révolutionnaire qui avait été condamnée à Vienne pour délit d’outrages aux mœurs, ce dont elle se vantait d’ailleurs, comme d’un titre de gloire. (...) La Trinité, Club de la délivrance — (...) Rien que des femmes. L’ordre du jour portait : “Moyens à prendre pour régénérer la société.” Une femme, âgée d’une trentaine d’années : “La plaie sociale qu’il faut d’abord fermer, c’est celle des patrons, qui exploitent l’ouvrier et s’enrichissent de ses sueurs. Plus de patrons qui considèrent l’ouvrier comme une machine de produit ! Que les travailleurs s’associent entre eux, qu’ils mettent leurs labeurs en commun et ils seront heureux. Un autre vice de la société actuelle, ce sont les riches, qui ne font que bien boire et bien s’amuser, sans prendre aucune peine. Il faut les extirper, ainsi que les prêtres et les religieuses. Nous ne serons heureuses que lorsque nous n’aurons plus ni patrons, ni riches, ni prêtres !” Club Saint-Sulpice — (...) Une nommée Gabrielle, fille d’une femme soumise : “Les prêtres, il faut les fusiller ; c’est eux qui nous empêchent de vivre comme nous voulons. Les femmes ont tort d’aller à confesse, j’en sais quelque chose. J’engage donc toutes les femmes à s’emparer de tous les curés et à leur brûler la gueule ! Quand il n’y en aura plus, nous serons heureuses.” (...) Louise Michel, la plus emportée, la plus violente de toutes : “Le grand jour est arrivé, s’écriait-elle à la séance du 17, le jour décisif pour l’affranchissement ou pour l’asservissement du prolétariat. Mais du courage, citoyens ; de l’énergie, citoyennes, et Paris sera à nous ; oui, je le jure, Paris sera à nous, ou Paris n’existera plus ! C’est pour le peuple une question de vie ou de mort” (7). »
Avec l’entrée des versaillais dans Paris le 21 mai 1871 commence la « semaine sanglante », « ces nuits tragiques qui sept fois tinteront », selon Victorine Brocher. « Samedi 27. Une fusillade des plus nourries nous assaille, une panique se produit, la foule arrive en criant : “Belleville est en partie pris, la mairie est abandonnée, il y a des morts et des blessés plein les rues, on tire sur nous de tous les côtés ; les fédérés et les volontaires se battent comme des lions.” Notre drapeau en tête, nous nous groupons pour le combat suprême ; il y avait des épaves de tous les bataillons. (...) Le 28 à midi, le dernier coup de canon fédéré part du haut de la rue de Paris ; la pièce bourrée à double charge exhale le dernier soupir de la Commune expirante. Le rêve achevé, la chasse à l’homme commence ! Arrestations ! Massacres ! (8) »
Et Louise Michel de conclure : « Je m’en vais avec le détachement du 61e au cimetière Montmartre, nous y prenons position. (...) La nuit était venue, nous étions une poignée, bien décidés. Certains obus venaient par intervalles réguliers ; on eût dit les coups d’une horloge, l’horloge de la mort. Par cette nuit claire, tout embaumée du parfum des fleurs, les marbres semblaient vivre. (...) Drapeau rouge en tête, les femmes étaient passées ; elles avaient leur barricade place Blanche, il y avait là Élisabeth Dmitrieff, madame Le Mel, Malvina Poulain, Blanche Lefebvre, Excoffon. André Léo [le pseudonyme de la journaliste Victoire Léodine Béra] était à celles des Batignolles. Plus de dix mille femmes aux jours de mai, éparses ou ensemble, combattirent pour la liberté. (...) Les légendes les plus folles coururent sur les pétroleuses, il n’y eut pas de pétroleuses — les femmes se battirent comme des lionnes, mais je ne vis que moi criant le feu ! le feu devant ces monstres ! Non pas des combattantes, mais de malheureuses mères de famille, qui dans les quartiers envahis se croyaient protégées par quelque ustensile faisant voir qu’elles allaient chercher de la nourriture pour leurs petits (une boîte au lait, par exemple), étaient regardées comme incendiaires, porteuses de pétrole, et collées au mur ! (...) Versailles étend sur Paris un immense linceul rouge de sang ; un seul angle n’est pas encore rabattu sur le cadavre. Les mitrailleuses moulent dans les casernes. On tue comme à la chasse ; c’est une boucherie humaine : ceux qui, mal tués, restent debout ou courent contre les murs, sont abattus à loisir. (...) Attirées par le carnage et suivant l’armée régulière, on vit, lorsque la Commune fut morte, apparaître un peu avant les mouches des charniers ces goules, remontant, elles aussi, au lointain passé, peut-être tout simplement folles, ayant la rage et l’ivresse du sang. Vêtues avec élégance, elles rôdaient à travers le carnage, se repaissant de la vue des morts, dont elles fouillaient du bout de leur ombrelle les yeux sanglants. Quelques-unes, prises pour des pétroleuses, furent fusillées sur le tas avec les autres (9). »
Éloi Valat
Peintre et dessinateur ; auteur de plusieurs ouvrages sur la Commune, dont L’Enterrement de Jules Vallès, Bleu autour, Saint-Pourçain-sur-Sioule, 2010.
Le Monde diplomatique juillet 2019 pages 14 et 15


N'oublions pas qu'en cas de révolte, les femmes sont, furent et/ou seront toujours en première ligne (1er et second degré déjà inclus
 )
)Je viens de tomber sur cet article qui date un peu mais qui rappelle au sujet du post.
Femmes de la Commune de Paris
Les Louises en insurrection
Blanchisseuses, relieuses, cantinières, journalistes… celles que leurs adversaires appelleront les « pétroleuses » interviennent splendidement dans les combats de la Commune : ceux qui se mèneront les armes à la main, ceux qui entreprennent de construire un monde plus juste et plus heureux. Elles sont privées du droit de vote, mais elles se font entendre dans les clubs de quartier, demandent l’égalité des salaires et la création de crèches, engagent la reconnaissance de l’union libre. La Commune fut exterminée, les idées et les idéaux survécurent.
Tous les dessins qui accompagnent cette double page sont d’Éloi Valat. Ils sont, pour la plupart, extraits de son ouvrage Louises, les femmes de la Commune, Bleu autour, Saint-Pourçain-sur-Sioule, 2019.
Le 26 mars 1871, 229 167 électeurs parisiens se rendent aux urnes pour désigner le conseil communal de « Paris, ville libre ». Une majorité révolutionnaire l’emporte. Des socialistes, des blanquistes, des républicains radicaux ou modérés composent cette nouvelle assemblée où les travailleurs manuels sont les plus nombreux, aux côtés d’employés, d’artisans patrons, de journalistes et de membres des professions libérales, pour la plus grande partie des hommes jeunes. Privées du droit de vote, les femmes sont absentes. Pas de citoyennes pour légiférer « la sociale ». Pourtant, elles sont actives et engagées, les femmes — et, comme le dit Jules Vallès, « Grand signe ! Quand les femmes s’en mêlent, quand la ménagère pousse son homme, quand elle arrache le drapeau noir qui flotte sur la marmite pour le planter entre deux pavés, c’est que le soleil se lèvera sur une ville en révolte (1) ».
Une dizaine de jours plus tôt, dans la nuit du 17 au 18 mars 1871, Adolphe Thiers, chef de l’exécutif de la République française, a ordonné l’enlèvement des canons de la garde nationale des parcs d’artillerie des Buttes-Chaumont, des Batignolles, de Montmartre... Prudence gouvernementale. Mais ces canons ont été payés par les Parisiens. La garde refuse. À 5 h 30, la troupe se répand dans les rues de Paris. Les dépêches militaires se succèdent. « 10 h 20. Beaucoup d’effervescence dans le XIIe [arrondissement]. Des gardes nationaux ont barré la rue de la Roquette par deux barricades ; d’autres descendent vers la Bastille... 10 h 30. Très mauvaise nouvelle de Montmartre. La troupe n’a pas voulu agir. Les Buttes, les pièces et les prisonniers ont été repris par les insurgés qui ne paraissent pas descendre (2). » Le tocsin ameute les quartiers populaires, de Belleville à la barrière d’Enfer (place Denfert-Rochereau). À Montmartre, les femmes et les enfants s’opposent vivement aux officiers du 88e de ligne. Des ménagères saisissent les rênes des chevaux, coupent les harnais, on crie : « Vous ne tirerez pas sur le peuple ! », « Vive la ligne ! »
Le 88e fraternise avec la foule. Louise Michel s’est précipitée, sa carabine sous son manteau : « Nous montions au pas de charge, sachant qu’au sommet il y avait une armée rangée en bataille. Nous pensions mourir pour la liberté. On était comme soulevés de terre. Nous morts, Paris se fût levé. Les foules à certaines heures sont l’avant-garde de l’océan humain. La butte était enveloppée d’une lumière blanche, une aube splendide de délivrance. (...) Ce n’était pas la mort qui nous attendait sur les Buttes (...) mais la surprise d’une victoire populaire. » Les généraux Claude Martin Lecomte et Jacques Léonard Thomas (dit Clément-Thomas), prisonniers des soldats insurgés, sont fusillés rue des Rosiers. Pour Louise Michel, « la Révolution était faite. Lecomte, arrêté au moment où pour la troisième fois il commandait le feu, fut conduit rue des Rosiers où vint le rejoindre Clément-Thomas, reconnu tandis qu’en vêtements civils il étudiait les barricades de Montmartre. Suivant les lois de la guerre ils devaient périr. (...) Le soir du 18 mars, les officiers qui avaient été faits prisonniers avec Lecomte et Clément-Thomas furent mis en liberté » (3).
Gaston Da Costa, alors aux côtés des insurgés, entendra dans ses Mémoires séparer le bon grain de l’ivraie : « Jusqu’au moment où la troupe lâche pied, ce sont les femmes qui dominent. Rue des Rosiers, à l’heure du meurtre, elles auront pour la plupart disparu. » Mais il ne recule pas, lui, le communard, devant l’évocation d’images fréquentes chez les adversaires de la Commune : « Cependant, aux épouses, aux mères a succédé, dans cette foule très mêlée, qui va escorter jusqu’aux buttes les prisonniers du Château-Rouge, l’horrible phalange des filles soumises et insoumises (...) sorties des hôtels, cafés et lupanars (...). Au bras des lignards, accompagnées de la légion des souteneurs, elles ont surgi, triste écume de la prostitution sur le flot révolutionnaire, et les voilà s’enivrant à tous les comptoirs, hurlant leur gueuse joie de cette défaite. (...) Joignez-y quelques pauvresses démoralisées par les atteintes délétères de la misère, qui, à l’angle de la rue Houdon, dépècent la chair, chaude encore, du cheval d’un officier tué quelques instants auparavant. Toutes se répandront dans Montmartre, promenant leur ivresse, leur folie haineuse, et feront une abominable escorte au malheureux Lecomte et à ses officiers, lorsqu’ils graviront le Calvaire des Buttes (4). »
Dix jours plus tard, le 28 mars, place de l’Hôtel-de-Ville, la Commune est proclamée « au nom du peuple ». La fête est grandiose. Le canon tonne pour saluer l’événement, le tocsin est muet. Victorine Brocher écrit : « Cette fois nous avions la Commune ! (...) Après tant de défaites, de misères et de deuils, il y eut une détente, tous étaient joyeux. (...) À la tête des bataillons au repos, des cantinières en costumes différents s’accoudent aux mitrailleuses. (...) Un membre de la Commune proclame les noms des élus du peuple, un cri s’élève, unanime : “vive la commune !” (5) »
Les femmes ne siègent pas dans l’assemblée communale. Elles manifestent, organisent leurs comités (d’arrondissement et de vigilance), rédigent adresses et manifestes, ces ambulancières, ces vivandières engagées au sein des bataillons de fédérés pour la défense des forts d’Issy et de Vanves, et bientôt sur les barricades de la « semaine sanglante ».
Le 11 avril, au Journal officiel — de la Commune —, paraît l’appel d’un « groupe de citoyennes » : « Paris est bloqué, Paris est bombardé... (...) Est-ce l’étranger qui revient envahir la France ? (...) Non, ces ennemis, ces assassins du peuple et de la liberté sont des Français !... (...) Ils ont vu le peuple se soulever en s’écriant : “Pas de devoirs sans droits, pas de droits sans devoirs ! (...) Nous voulons le travail, mais pour en garder le produit... Plus d’exploiteurs, plus de maîtres !... Le travail et le bien-être pour tous, le gouvernement du peuple par lui-même, la Commune, vivre libres en travaillant ou mourir en combattant !” »
Le 12 avril, dans Le Cri du peuple : « Que la commune ouvre donc immédiatement aux femmes trois registres sous ces titres : Action armée, Postes de secours aux blessés, Fourneaux ambulants. Elles s’inscriront en foule, heureuses d’utiliser la sainte fièvre qui brûle les cœurs. »
Le 14 avril, au Journal officiel, l’Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés souligne : « Il est du devoir et du droit de tous de combattre pour la grande cause du peuple, pour la Révolution. (...) La Commune, représentante du grand principe proclamant l’anéantissement de tout privilège, de toute inégalité, par là même est engagée à tenir compte des justes réclamations de la population entière, sans distinction de sexe, distinction créée et maintenue par le besoin de l’antagonisme sur lequel reposent les privilèges des classes gouvernantes. »
Dans les clubs, ouverts dans les églises et parfois exclusivement féminins, la parole est libérée. Tout est sujet à prêches et à débats : la défense de la révolution, l’éducation des filles, la parité des salaires, les lois sociales, l’union libre, la lâcheté des hommes, la fin de l’exploitation du travail... Le 3 mai, à l’ouverture du Club de la révolution sociale, dans l’église Saint-Michel comble, à Batignolles, « on sentait qu’en partant se battre pour la Commune les maris avaient laissé au logis un germe solide d’idées révolutionnaires ». On se quitte sur Le Chant du départ et la Marseillaise, avec pour ordre du jour de la prochaine séance : « La femme par l’Église et par la Révolution » (6).
Paul de Fontoulieu, d’une plume acrimonieuse trempée dans le bénitier versaillais, décrit à charge ce qu’il dit y avoir vu et entendu : « Club Éloi — Parmi les oratrices, pardon du mot, (...) la citoyenne Valentin, fille publique qui, le 22 mai, brûla la cervelle à son souteneur, parce qu’il ne voulait pas aller sur les barricades. Et la citoyenne Morel, qui avait subi cinq condamnations (...) : “Je demande, pour en finir, que l’on jette dans la Seine toutes les religieuses, il y en a dans les hôpitaux qui donnent du poison aux fédérés blessés.” Église Saint-Lambert à Vaugirard, Club des femmes patriotes — La réunion de Vaugirard fut présidée par une Autrichienne, du nom de Reidenhreth, (...) une sorte de bas-bleu révolutionnaire qui avait été condamnée à Vienne pour délit d’outrages aux mœurs, ce dont elle se vantait d’ailleurs, comme d’un titre de gloire. (...) La Trinité, Club de la délivrance — (...) Rien que des femmes. L’ordre du jour portait : “Moyens à prendre pour régénérer la société.” Une femme, âgée d’une trentaine d’années : “La plaie sociale qu’il faut d’abord fermer, c’est celle des patrons, qui exploitent l’ouvrier et s’enrichissent de ses sueurs. Plus de patrons qui considèrent l’ouvrier comme une machine de produit ! Que les travailleurs s’associent entre eux, qu’ils mettent leurs labeurs en commun et ils seront heureux. Un autre vice de la société actuelle, ce sont les riches, qui ne font que bien boire et bien s’amuser, sans prendre aucune peine. Il faut les extirper, ainsi que les prêtres et les religieuses. Nous ne serons heureuses que lorsque nous n’aurons plus ni patrons, ni riches, ni prêtres !” Club Saint-Sulpice — (...) Une nommée Gabrielle, fille d’une femme soumise : “Les prêtres, il faut les fusiller ; c’est eux qui nous empêchent de vivre comme nous voulons. Les femmes ont tort d’aller à confesse, j’en sais quelque chose. J’engage donc toutes les femmes à s’emparer de tous les curés et à leur brûler la gueule ! Quand il n’y en aura plus, nous serons heureuses.” (...) Louise Michel, la plus emportée, la plus violente de toutes : “Le grand jour est arrivé, s’écriait-elle à la séance du 17, le jour décisif pour l’affranchissement ou pour l’asservissement du prolétariat. Mais du courage, citoyens ; de l’énergie, citoyennes, et Paris sera à nous ; oui, je le jure, Paris sera à nous, ou Paris n’existera plus ! C’est pour le peuple une question de vie ou de mort” (7). »
Avec l’entrée des versaillais dans Paris le 21 mai 1871 commence la « semaine sanglante », « ces nuits tragiques qui sept fois tinteront », selon Victorine Brocher. « Samedi 27. Une fusillade des plus nourries nous assaille, une panique se produit, la foule arrive en criant : “Belleville est en partie pris, la mairie est abandonnée, il y a des morts et des blessés plein les rues, on tire sur nous de tous les côtés ; les fédérés et les volontaires se battent comme des lions.” Notre drapeau en tête, nous nous groupons pour le combat suprême ; il y avait des épaves de tous les bataillons. (...) Le 28 à midi, le dernier coup de canon fédéré part du haut de la rue de Paris ; la pièce bourrée à double charge exhale le dernier soupir de la Commune expirante. Le rêve achevé, la chasse à l’homme commence ! Arrestations ! Massacres ! (8) »
Et Louise Michel de conclure : « Je m’en vais avec le détachement du 61e au cimetière Montmartre, nous y prenons position. (...) La nuit était venue, nous étions une poignée, bien décidés. Certains obus venaient par intervalles réguliers ; on eût dit les coups d’une horloge, l’horloge de la mort. Par cette nuit claire, tout embaumée du parfum des fleurs, les marbres semblaient vivre. (...) Drapeau rouge en tête, les femmes étaient passées ; elles avaient leur barricade place Blanche, il y avait là Élisabeth Dmitrieff, madame Le Mel, Malvina Poulain, Blanche Lefebvre, Excoffon. André Léo [le pseudonyme de la journaliste Victoire Léodine Béra] était à celles des Batignolles. Plus de dix mille femmes aux jours de mai, éparses ou ensemble, combattirent pour la liberté. (...) Les légendes les plus folles coururent sur les pétroleuses, il n’y eut pas de pétroleuses — les femmes se battirent comme des lionnes, mais je ne vis que moi criant le feu ! le feu devant ces monstres ! Non pas des combattantes, mais de malheureuses mères de famille, qui dans les quartiers envahis se croyaient protégées par quelque ustensile faisant voir qu’elles allaient chercher de la nourriture pour leurs petits (une boîte au lait, par exemple), étaient regardées comme incendiaires, porteuses de pétrole, et collées au mur ! (...) Versailles étend sur Paris un immense linceul rouge de sang ; un seul angle n’est pas encore rabattu sur le cadavre. Les mitrailleuses moulent dans les casernes. On tue comme à la chasse ; c’est une boucherie humaine : ceux qui, mal tués, restent debout ou courent contre les murs, sont abattus à loisir. (...) Attirées par le carnage et suivant l’armée régulière, on vit, lorsque la Commune fut morte, apparaître un peu avant les mouches des charniers ces goules, remontant, elles aussi, au lointain passé, peut-être tout simplement folles, ayant la rage et l’ivresse du sang. Vêtues avec élégance, elles rôdaient à travers le carnage, se repaissant de la vue des morts, dont elles fouillaient du bout de leur ombrelle les yeux sanglants. Quelques-unes, prises pour des pétroleuses, furent fusillées sur le tas avec les autres (9). »
Éloi Valat
Peintre et dessinateur ; auteur de plusieurs ouvrages sur la Commune, dont L’Enterrement de Jules Vallès, Bleu autour, Saint-Pourçain-sur-Sioule, 2010.
Le Monde diplomatique juillet 2019 pages 14 et 15



Max 31- Membre incontournable !

- Messages : 834
Date d'inscription : 19/02/2021
Age : 64
 Sujets similaires
Sujets similaires» Grosse manif commune à Paris !
» Une commune condamnée pour un ralentisseur non conforme
» une commune condamnée après l’accident mortel d’un motard
» Quand rugby et Sécurité routière font cause commune
» Une commune condamnée pour un ralentisseur non conforme
» une commune condamnée après l’accident mortel d’un motard
» Quand rugby et Sécurité routière font cause commune
Goldwing Indépendant :: Le bar :: Le bar
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum


